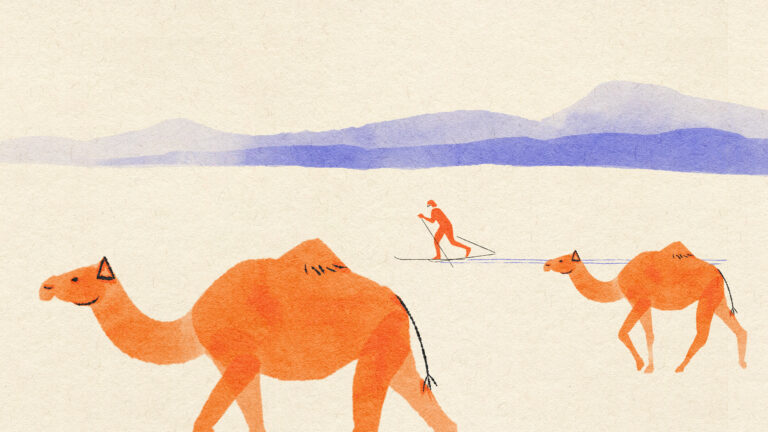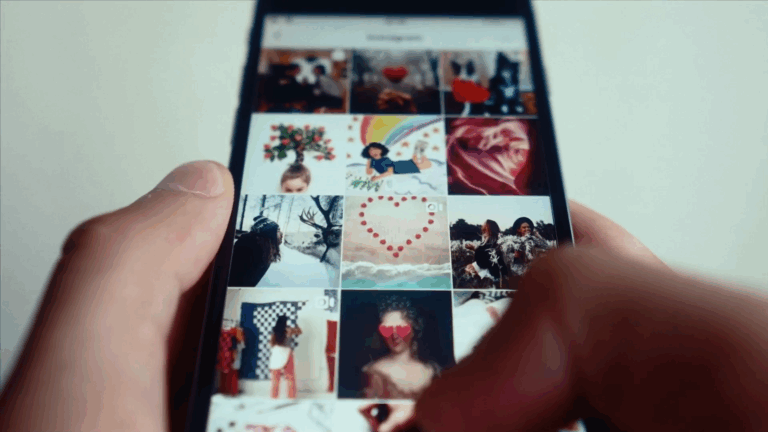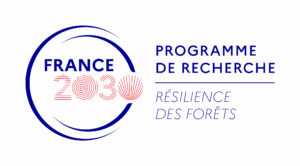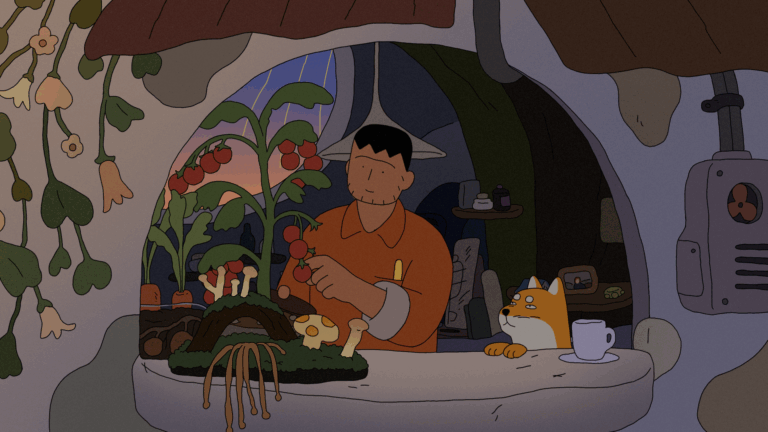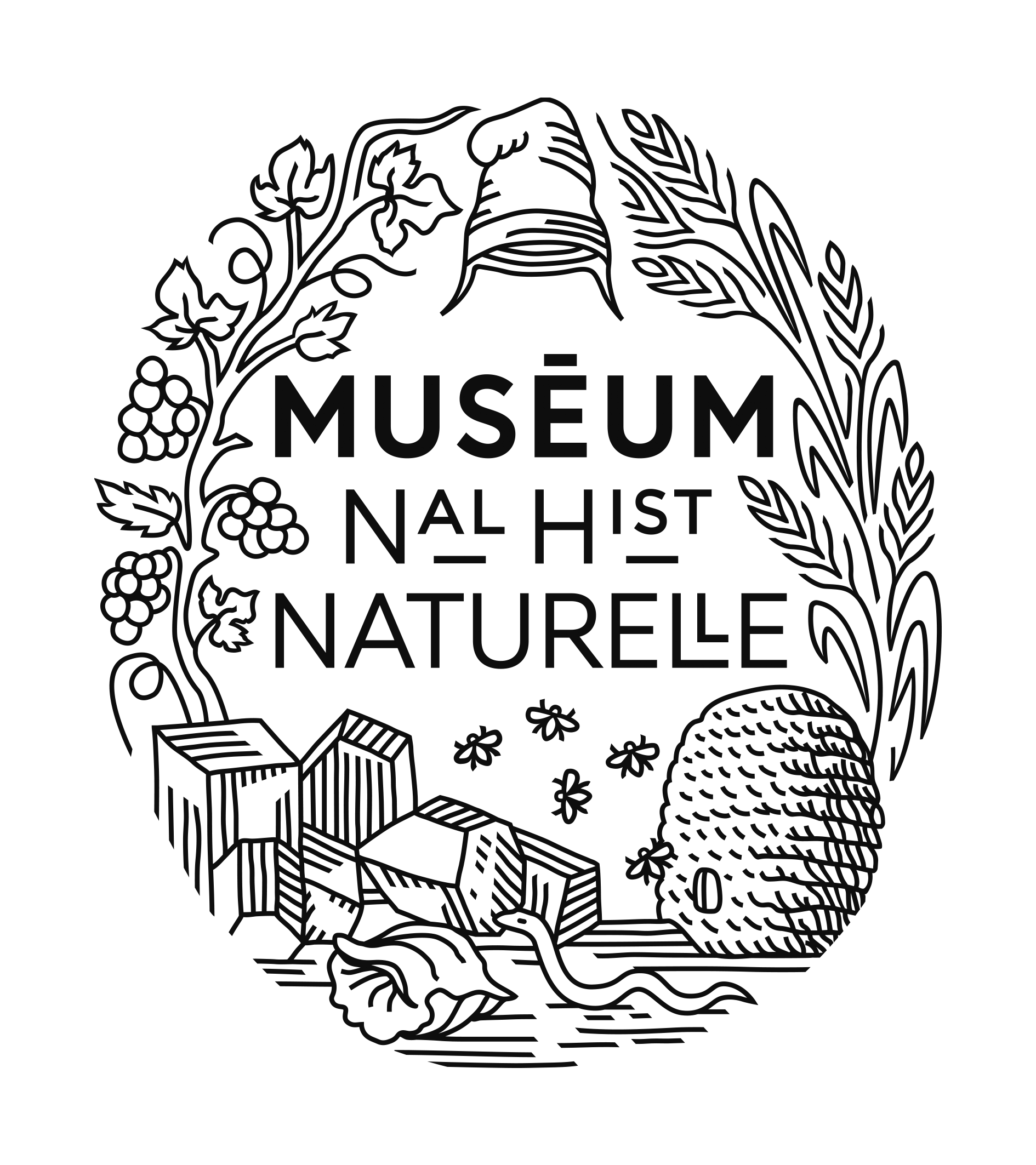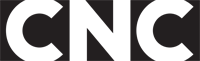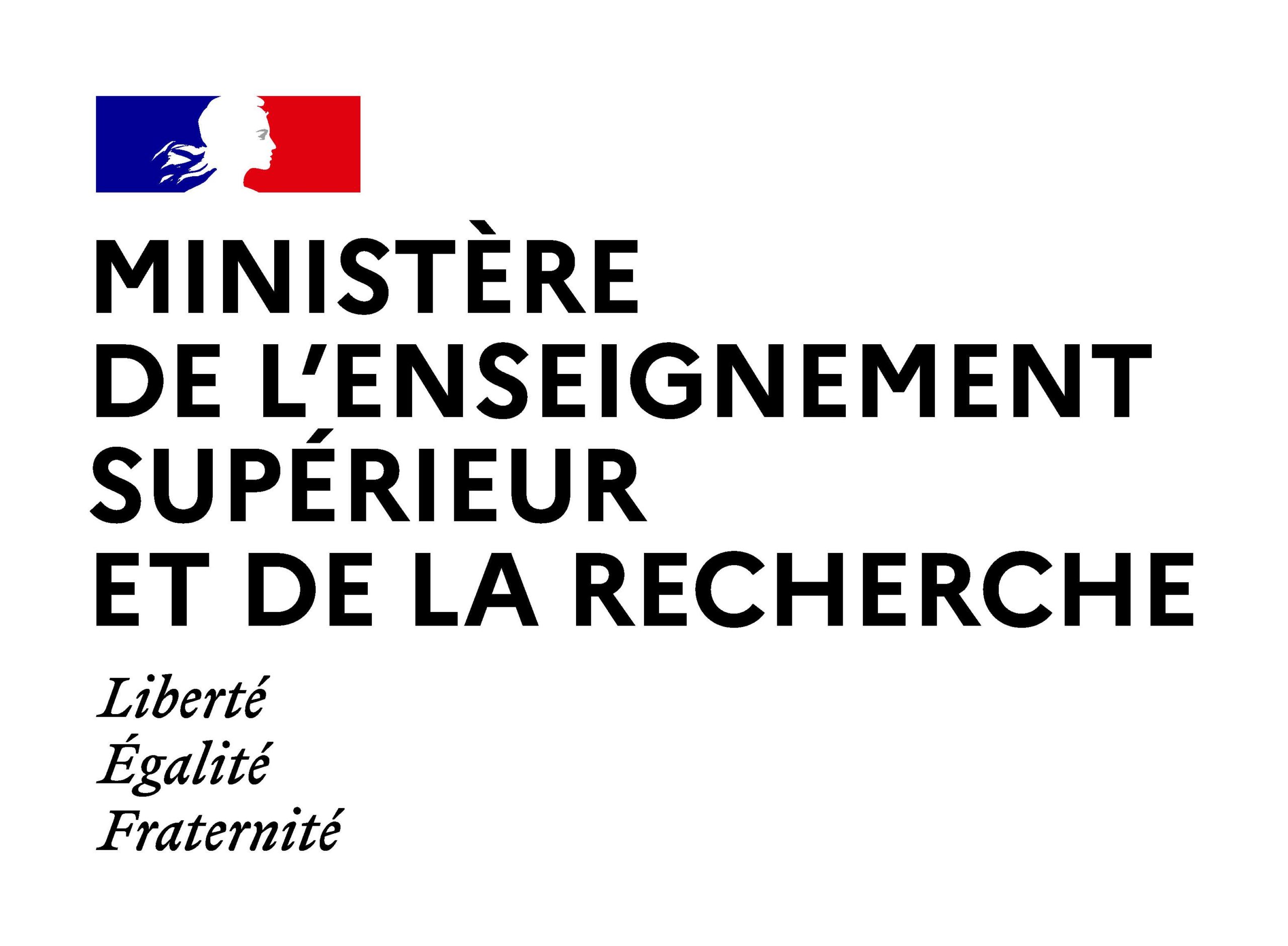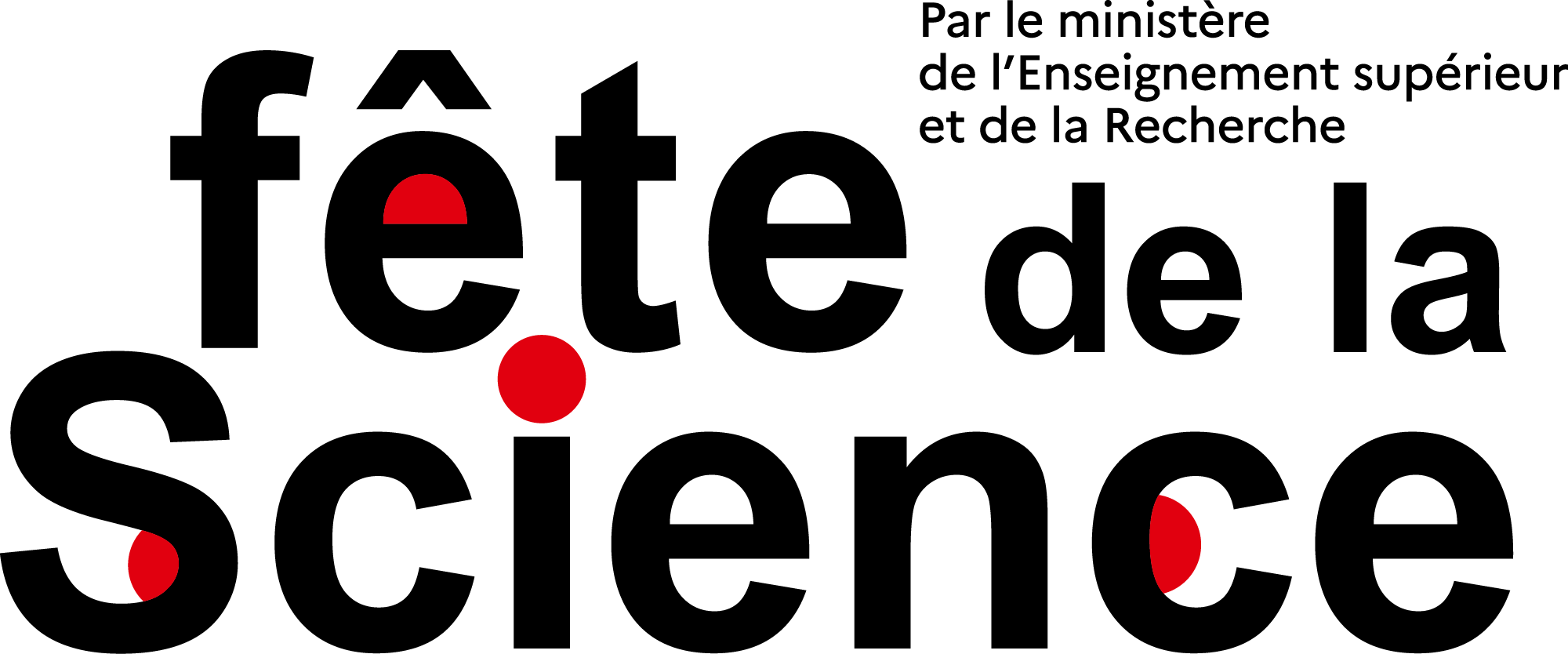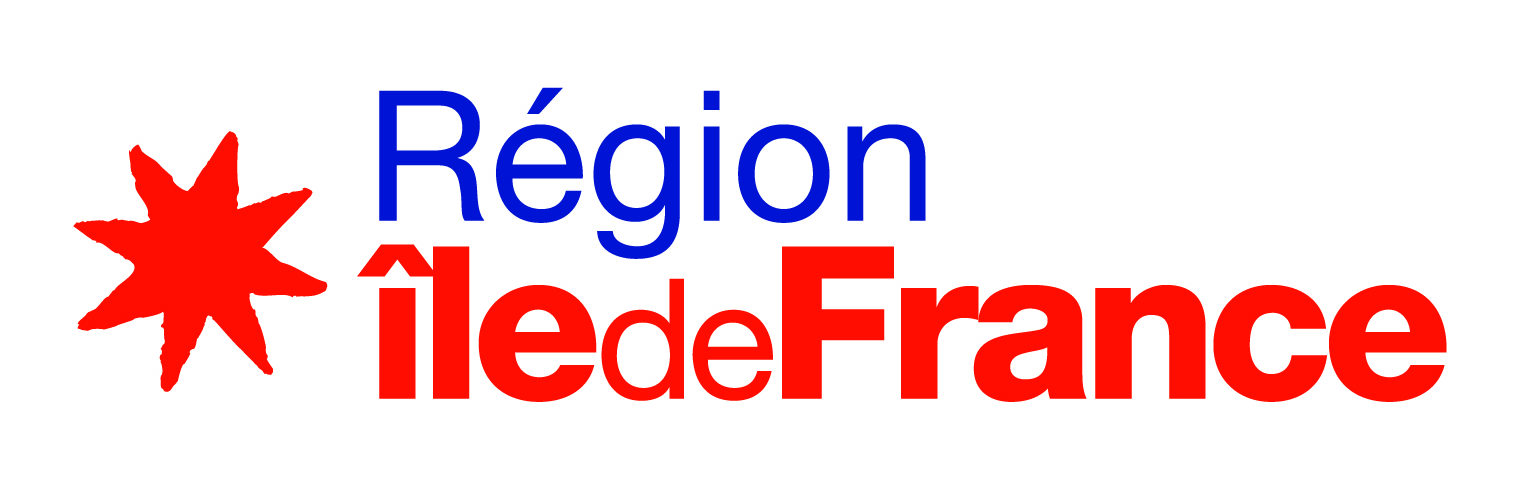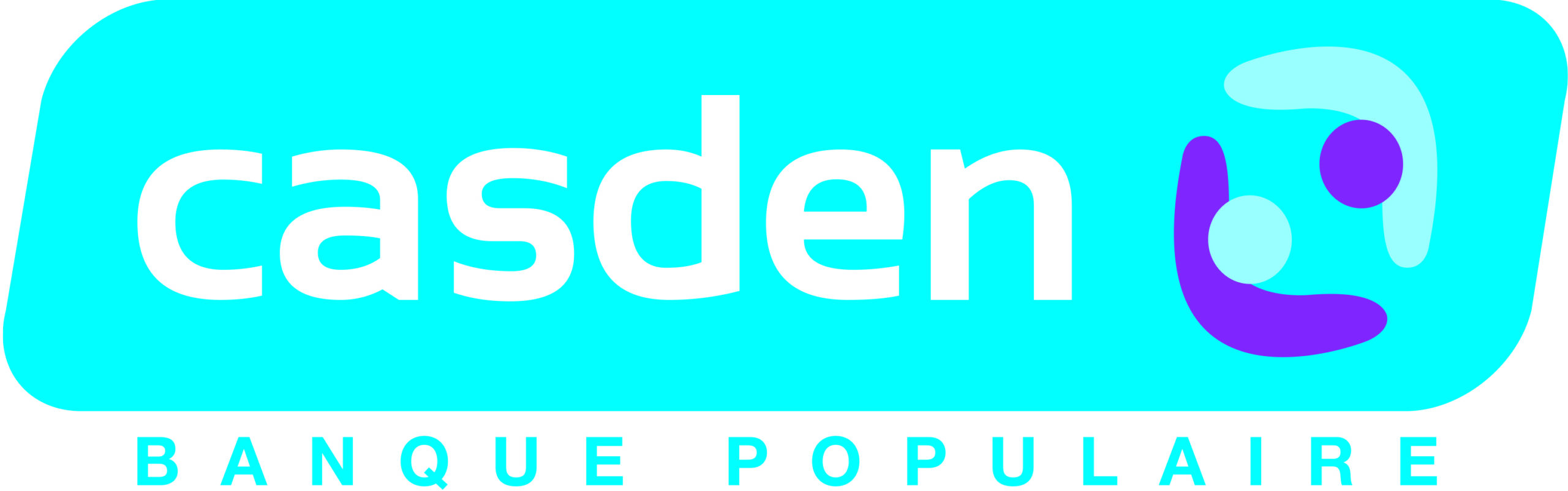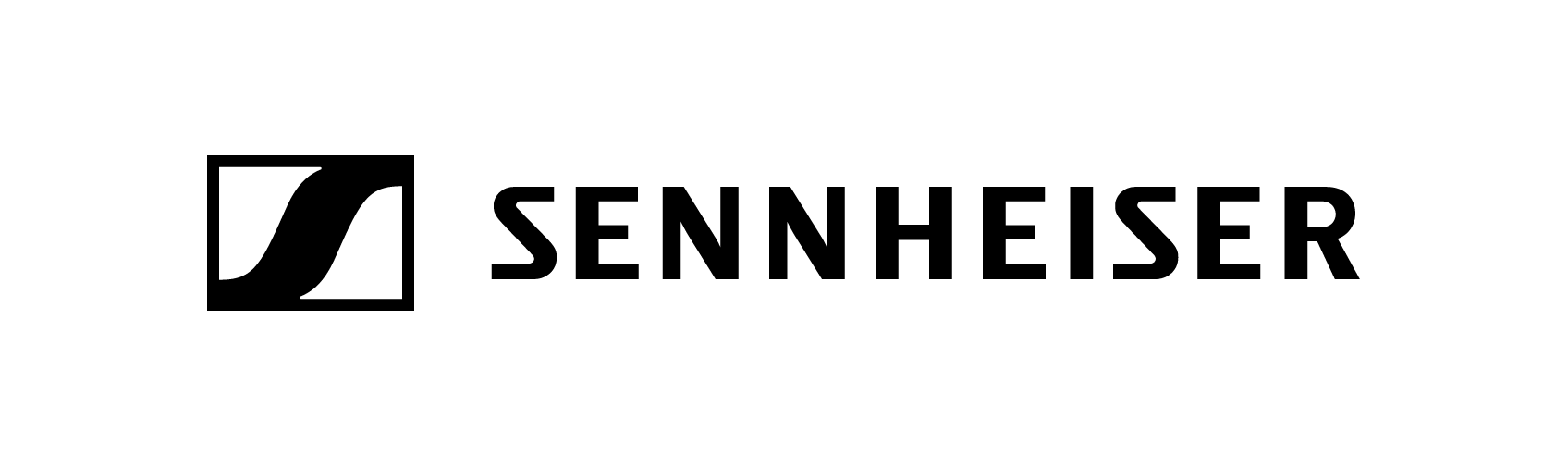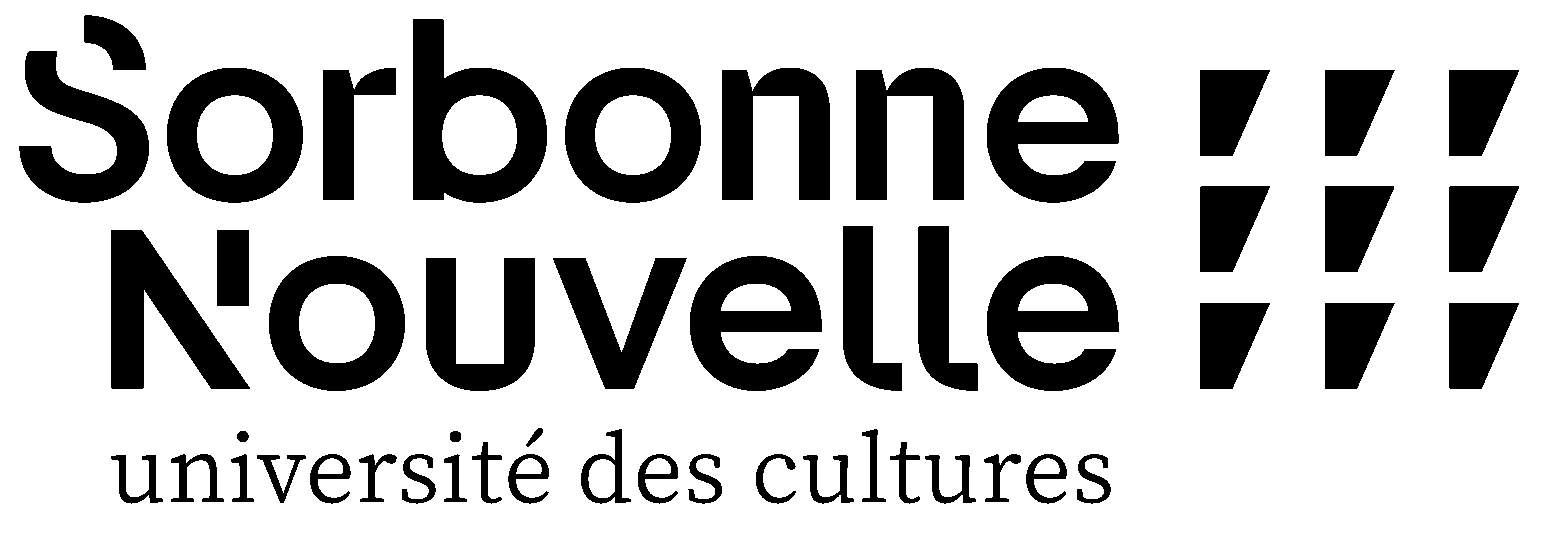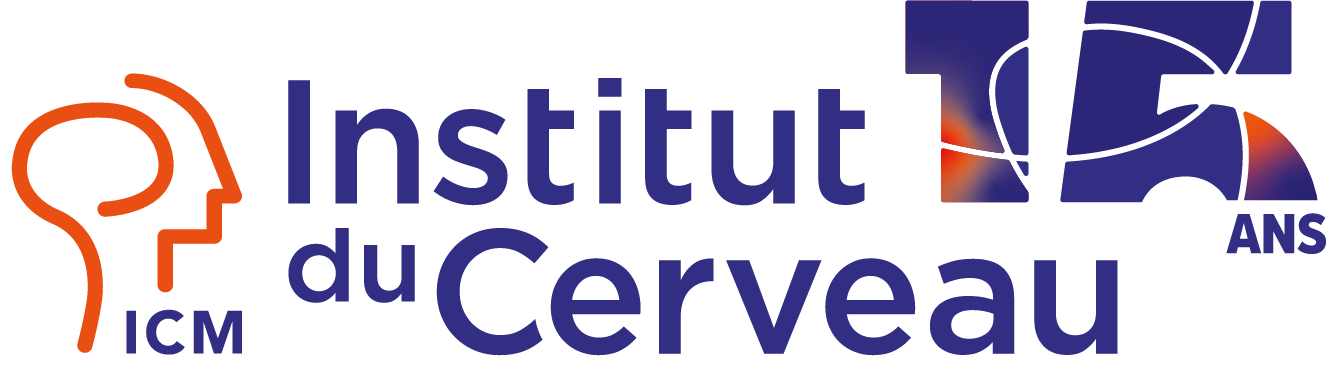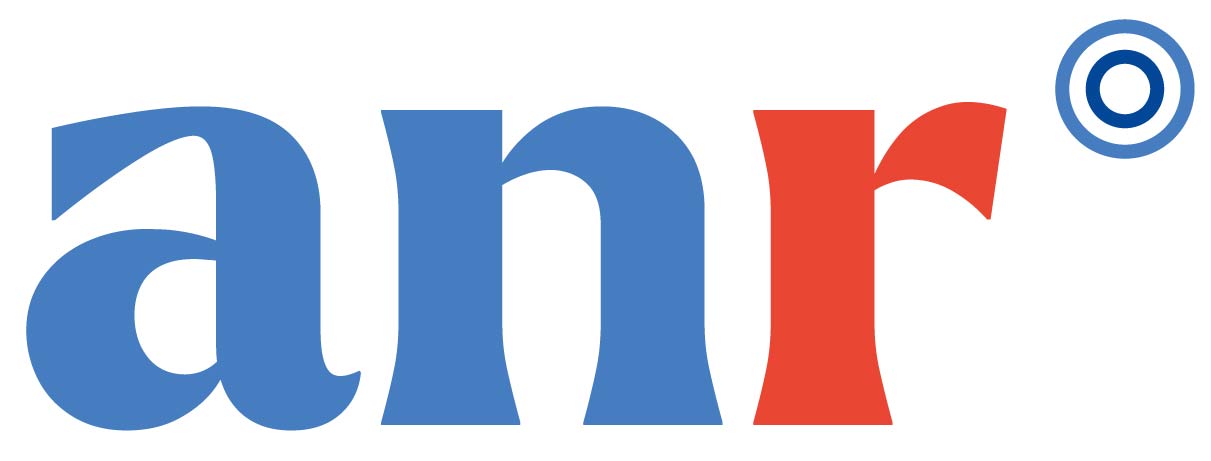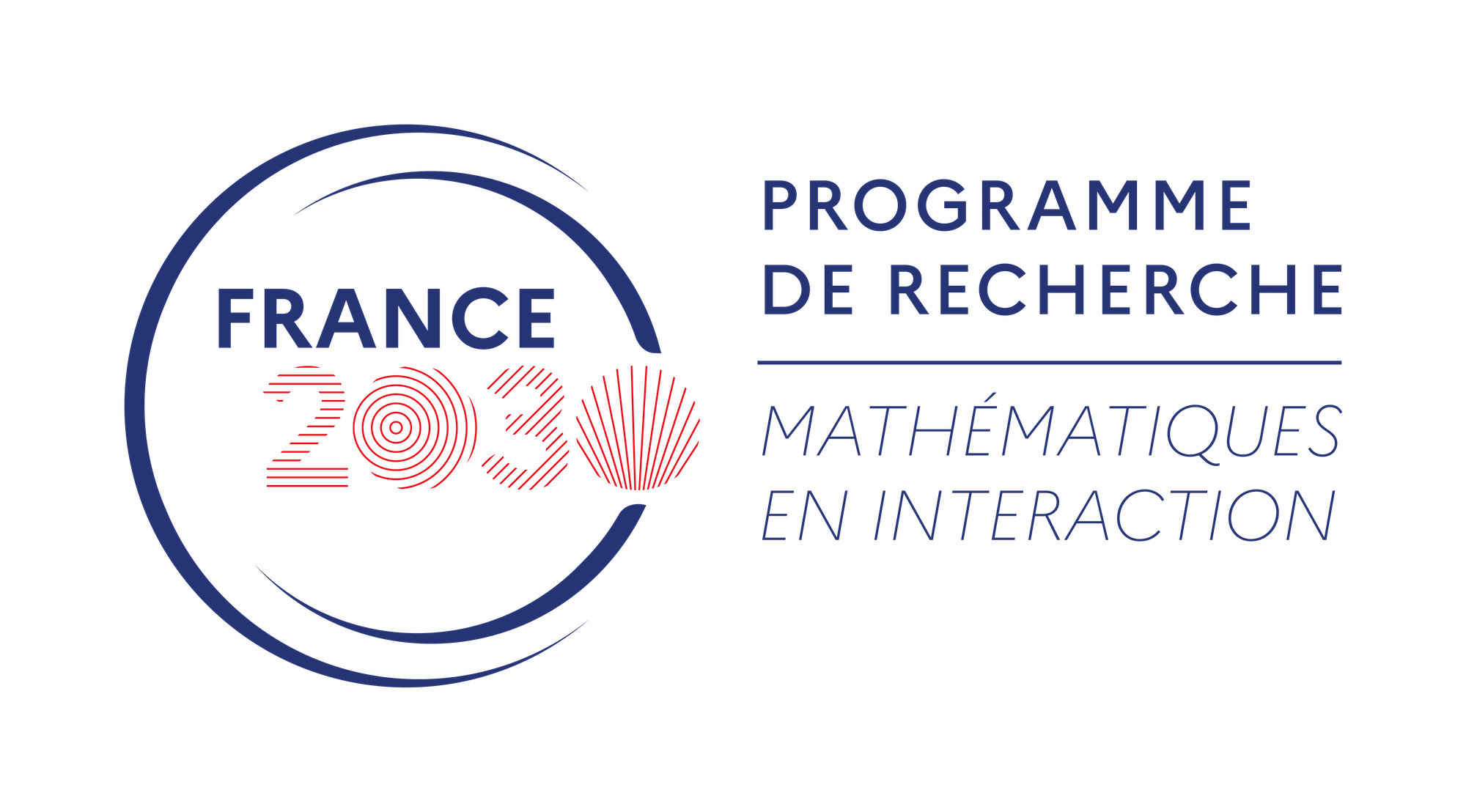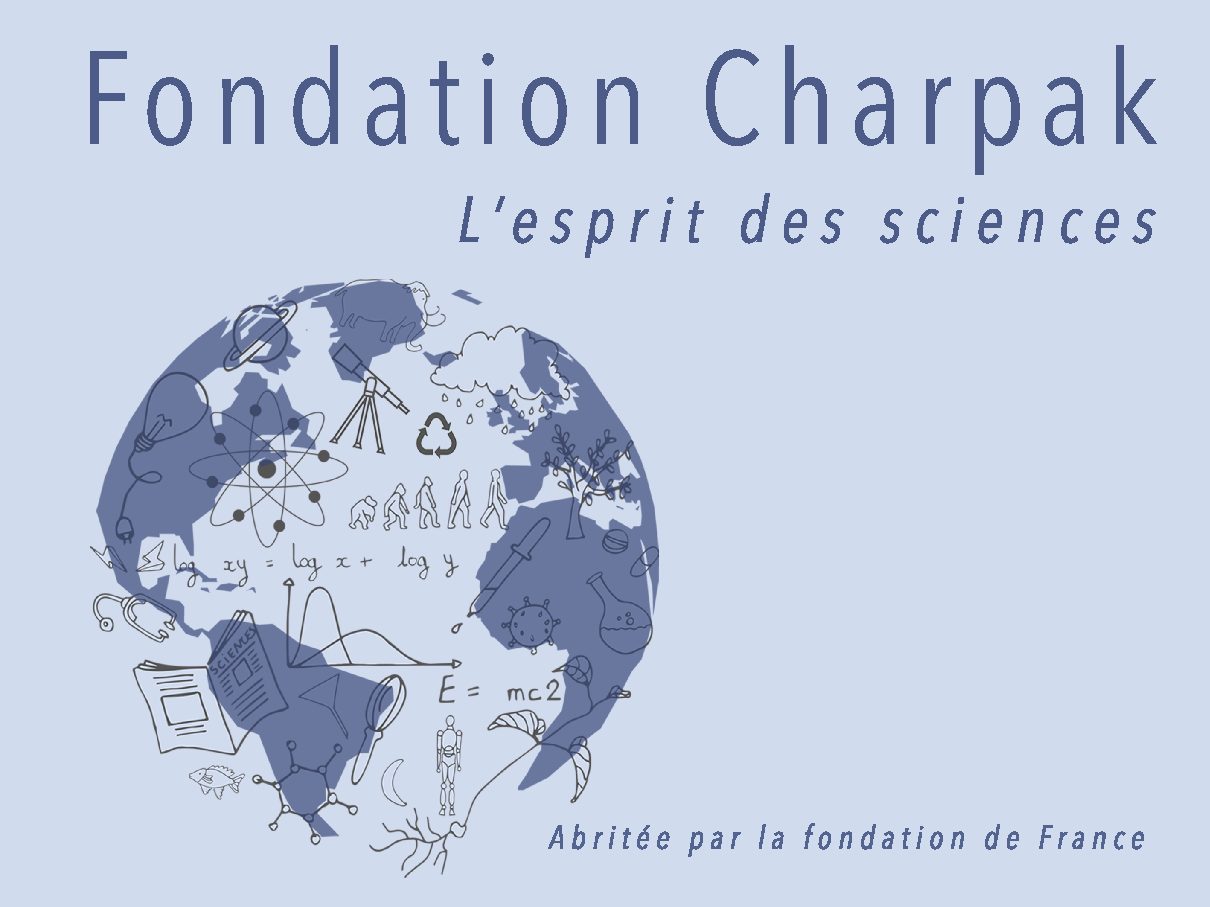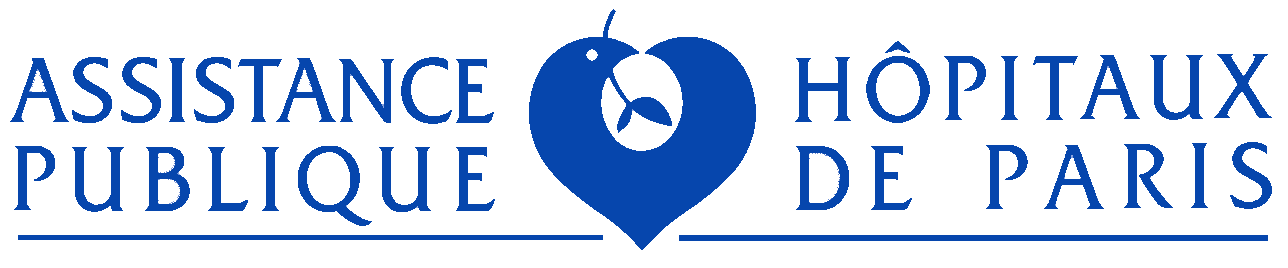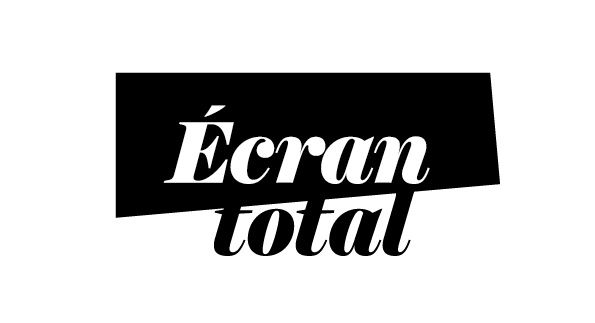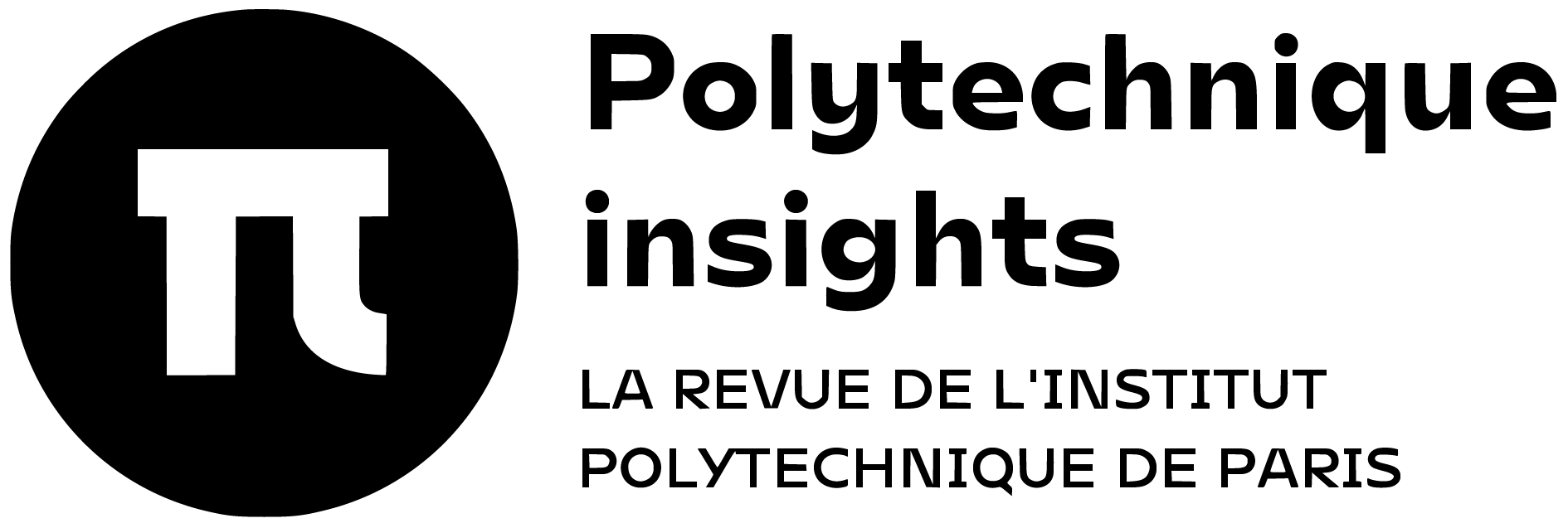03 Octobre 2025 - 11h00 - 15h30 Complet
03 Octobre 2025 - 11h00 - 15h30 Complet Journée autour de la lumière au Synchrotron SOLEIL [Session 1]
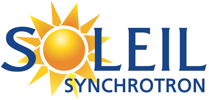
[AVANT-PREMIÈRE]
Une journée inédite couplant projections de films et visite d'un impressionnant accélérateur de particules utilisant la lumière attend vos élèves au Synchrotron SOLEIL.
Suite à la visite guidée de cette infrastructure de recherche majeure, les élèves découvriront en avant-première, en même temps que des scientifiques du centre, trois épisodes de la série documentaire Origines - Un conte de la lumière, une série documentaire scientifique expérimentale, poétique et haute en couleurs, qui donne la parole à la Lumière, pour raconter l’histoire de l’univers, en présence du réalisateur.